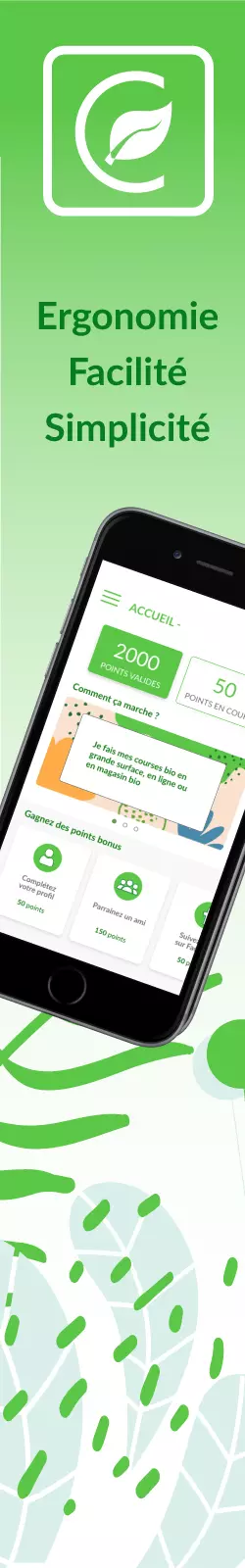Une mode durable est-elle possible ?

La mode peut-elle être véritablement durable ? C’est une question à laquelle ont tenté de répondre les invités de la conférence “Recycler la mode” du séminaire annuel Anthropologies de la mode, organisé, en février dernier, par l’EHESS (Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales). Décryptage.
Au tableau de cet événement, Anne-Gwenn Alexandre, juriste en droit de l’environnement, Adèle Rinck de l'organisme du textile ECO-TLC et Dominique Bourg, philosophe, spécialiste des questions environnementales ; ont émi leurs avis et interprétations sur la recyclabilité dans le dur monde de la mode. Alors la mode est elle durable ?
“On le sait tous ici, l’industrie la plus polluante, après celle des carburants fossiles, c’est l’industrie de la mode”. C’est ainsi que Anne-Gwenn Alexandre a entamé sa présentation. Depuis quelques années maintenant, la mode éthique interroge et se veut une alternative aux dérives de la fast fashion. Il y a d’abord l’impact humain de cette mode destructrice qui a, à de nombreuses reprises coûté, la vie aux travailleurs précaires de cette industrie. Mais il y a aussi l’impact environnemental tout aussi désastreux.
Plus de 10 000 litres d’eau pour un jean
Il faut près de 11 000 litres d’eau pour produire un jean en coton. À titre de comparaison, cela représente le volume consommé par une famille de 6 personnes en un peu plus d’un mois (tous types de consommations confondues, autant alimentaire qu’utilitaire) dans un pays comme le Bangladesh. De plus, les eaux utilisées sont parfois potables et sont ensuite rejetées dans la nature complètement polluées.
“En France, chaque année, près de 2,6 milliards de pièces sont mises sur le marché du prêt-à-porter”, explique Adèle Rinck, de l’organisme Eco-TLC. Toutes ne seront, bien entendu, pas vendues, malgré les multiples coups marketing des marques pour écouler les stocks à moindre coût. Résultat : de nombreux produits seront détruits par les marques. Le champion en la matière reste la marque suédoise H&M, qui est également un des exemple les plus aboutis de la fast-fashion. En 2017, une émission danoise mettait en lumière une pratique désastreuse pour l'environnement. Depuis 2013, la firme de prêt-à-porter brûle ses invendus. Pour cette même année, cela représente près de 60 tonnes de vêtements. L’entreprise, consciente certainement de ces critiques, se targue depuis quelques années de pratiquer une économie de plus en plus circulaire et souhaite favoriser la mode durable. Le constat est pourtant loin de cet idéal. La mode et le prêt-à-porter tout particulièrement sont entrés depuis longtemps dans une spirale de production excessive, encouragée par la mondialisation économique. La concurrence est rude. L’innovation est donc de mise. Les collections ne sont plus renouvelées par saison, mais par mois, voire dans certains cas par semaine. Au détriment des travailleurs précaires qui sont soumis à des rythmes intenables, mais aussi de la préservation de l’environnement.
Dans le cas de H&M, Greenpeace avait épinglé la marque dans un rapport pour son usage de produits toxiques dans des vêtements pour enfants. Des produits, comme les teintures des textiles, dont les rejets sont souvent expulsés dans la nature environnante.
Fièvre acheteuse
Si les invendus représentent une masse encore trop importante, le consommateur continue de se ruer dans les magasins. Malgré cette frénésie, 70 % de notre garde-robe n’est pas portée et de nombreuses pièces finissent à la poubelle, rappelle Anne Gwenn Alexandre. Sur 12 kg de vêtements achetés chaque année en France, seul 2,5 kg seront recyclés. Cela génère énormément de déchets, qui plus est, potentiellement toxiques. L’industrie de la mode est la deuxième industrie la plus pollueuse d’eau juste après l’agriculture.
Quel modèle sommes-nous donc en train de léguer à nos enfants ? Dominique Bourg a sa petite explication. “Ce qui est arrivé, c’est que l'avènement de la science moderne a opéré une véritable rupture de notre représentation de la nature”, explique le philosophe. Pour lui, elle ne représente plus qu’un agrégat, des particules extérieures sans finalité. Concernant les animaux, “on ne les voit plus que comme des machines”, dit le penseur. Aujourd’hui, nous sommes seulement là pour la dominer. Dans l’industrie de la mode, qui est une des modalités d’expression de l’homme, la nature, considérée comme une ressource, est abondamment mise à profit pour assouvir ce besoin. Un besoin devenu limite primaire. “Accomplir son humanité, c’est posséder”, conclut Dominique Bourg.
L’habillement est depuis des siècles une marque de distinction sociale, économique parfois même intellectuelle. Ajoutez-y pour notre époque, la pression des réseaux sociaux, où l’information est partagée à la seconde et où les blogs de mode sont devenus modèles en la matière. Des modèles consuméristes, ou le quantitatif prime parfois sur le qualitatif. Une aubaine pour les grandes marques qui ne se font pas prier pour répondre à ses attentes.
Le réveil des consommateurs
En réalité, il est peut-être un peu exagéré de dire que rien n’est fait pour activer une transformation écologique de la mode. Un événement en particulier a agit comme un véritable choc pour de nombreux consommateurs : l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, en 2013. Ce bâtiment en ruine abritait plus de 3000 employés qui travaillaient pour de grandes firmes de l’industrie textile comme Mango ou Primark. Malgré les multiples alertes des employés, les responsables ne donneront pas l’ordre d’évacuation, forcés de répondre aux exigences des marques qui imposent une cadence de production infernale. L'effondrement du Rana Plaza va causer la mort de 1127 personnes. Il entraîne alors une vague d’indignation auprès de ceux qui se faisaient déjà l’écho de cet esclavage moderne et suscite multiples interrogations des consommateurs lambda. C’est alors le début des mouvements contestataires de la fast-fashion. La Fashion Revolution voit alors le jour. Durant une semaine en avril, les consommateurs sont invités à questionner les marques sur les conditions de fabrication de leurs vêtements. Car les petites mains, en plus des conditions de travail désastreuses, sont exposées à des substances chimiques très toxiques. Ces produits sont parfois déversés dans la nature environnante. Dans le cas du Bangladesh, cela peut créer des situations sanitaires ingérables, le pays subissant la plus importante contamination de masse de l’histoire.
Quels rôles pour les institutions ?
Que font nos gouvernements pour réduire l’impact environnemental des vêtements, qui sont souvent portés dans notre partie du globe. En France, depuis le 1er janvier 2007, toute personne qui met sur le marché des produits textiles (habillement, chaussures, linge de maison) est tenue de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits (Article L 541-10-3 et R 543-214 du Code de l'environnement). En théorie, la loi française impose aux fabricants ou revendeurs de veiller au recyclage de leurs produits.
En pratique, cela paraît impossible. Anne Gwenn Alexandre cite également les objectifs de développement durable des Nations Unies. L’objectif numéro 12, qui concerne la production et la consommation durable, prévoit de nombreux objectifs qui pourrait concerner l’industrie de la mode. Ils prévoient notamment de parvenir à une gestion durable des ressources naturelles, d’instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie et de promouvoir les pratiques durables autant à l’échelle citoyenne qu'à l'échelle des entreprises. En 2011, une loi européenne a contraint les marques à apposer sur les vêtements un étiquetage sur lequel figure un pourcentage de chaque fibre composant le produit ainsi que le pays de fabrication du vêtements. Une avancée pour le consommateur qui peut refuser de porter des vêtements synthétiques où de provenance de pays ou les législations ne garantissent pas le respect du droit des travailleurs. Enfin, dernière avancée mais pas des moindres comme le souligne Anne Gwenn Alexandre, dès le 1er avril 2019, une loi interdira aux marques de jeter ou brûler des vêtements neufs sous peine d’une amende de 450 euros par vêtements… Mais sur le sol français uniquement.
Favoriser le recyclage des vêtements
En France, des initiatives comme Eco-TLC voient le jour. Cette société privée et non lucratif, qui est née d’une initiative multi-acteurs participe, à favoriser le recyclage des TLC (Textiles, linge de maison et chaussures). Si les questions se font nombreuses et dubitatives en raison du financement de cet organisme par les marques elles-mêmes, Adèle Rinck l’assure : “leur participation est indispensable pour changer le système”. L’organisme qui se dit ‘tisseur de liens” entre les différentes filières est à l'origine de l’initiative “la fibre du tri”. Une plateforme qui recense les points de collectes des TLC et promeut les initiatives innovantes en la matière. L’éco-organisme se fait ainsi chantre de l'upcycling et promet de changer les habitudes des consommateurs et des producteurs qui sont parfois les plus réticents. S’il y a quelques années, les initiatives écologiques ne faisaient pas beaucoup d’adeptes dans les grandes entreprises de mode, aujourd’hui, ils sont régulièrement sollicités pour accompagner ces entreprises dans leur transition écologique, affirme Adèle Rinck.
Alors une mode durable est-elle possible ?
La mode durable existe déjà. Elle se développe avec des petites marques comme Veja, People Tree, ou encore Loom. Ces marques, souvent basées sur un modèle économique particulier, convainquent de plus en plus. La mode durable se démocratise et il n’est plus rare de retrouver des griffes écolo sur des sites de vente en ligne comme Asos ou Zalando. Mais elle n’en est pas pour autant accessible à tous. En cause, les prix souvent plus onéreux que la moyenne. Comptez au moins 60 euros pour un sweat chez Loom et 30 euros en moyenne chez Celio, une marque de prêt-à-porter masculine très répandue. Loom ne dispose aussi certainement pas du même budget marketing et n’est donc pas en mesure de pratiquer autant de réductions de prix et bons plans.
La mode durable est encore souvent réservée aux plus favorisés de nos sociétés et à un public aguerri, souvent sensible à l’impact environnemental de sa consommation textile. Une mode totalement durable est-elle possible ? Ce scénario est aussi plausible que le scénario des 1,5 degrés présenté par le GIEC pour sortir de la crise climatique. Il faut un changement très significatif du modèle des entreprises leaders du prêt-à-porter mais aussi un changement des habitudes des consommateurs qui privilégieraient le qualitatif au quantitatif. Cela passe par une éducation et une sensibilisation accrues aux thématiques de préservation de l’environnement. Mais surtout, par une remise en question du système tout entier. Car la fabrication des vêtements implique également l’industrie du transports, l’industrie agricole ou encore l’imprimerie, pour les étiquettes. Une mode complètement durable ne pourra exister que si un changement universel est opéré en faveur de la protection de l’environnement.