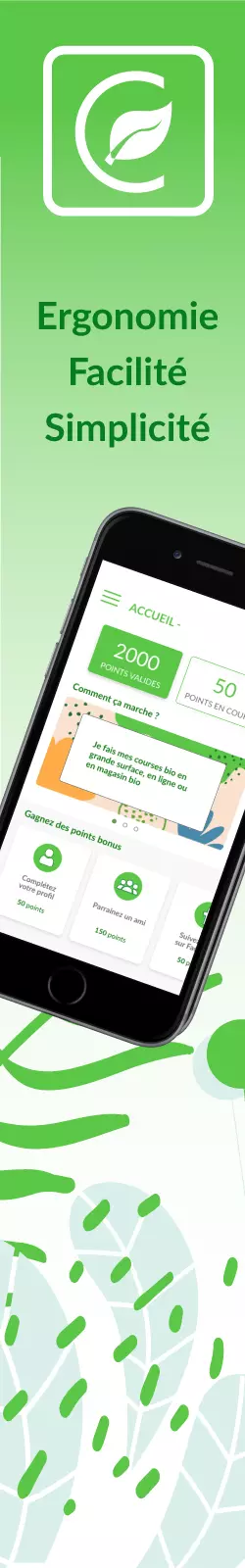Le défi locavore de Marie : vivre 2 mois en mangeant 100% local

66 jours pour manger local, et en circuit court. Voilà le défi que s’est fixé Marie, pétulante trentenaire amoureuse de la bonne bouffe. Celle qui a du goût, qui fait plaisir, mais qui répond aussi à des critères éthiques comme une juste rémunération des producteurs, trop souvent oubliés derrière nos boîtes de nourriture industrielle.
À trente-et-un an, cette parisienne s’est lancée dans l’aventure du tout local. De petites galères en belles découvertes, elle revient pour nous sur ces 66 jours d’expérience qui ont changé son rapport à la nourriture. 66 jours à pédaler à la recherche de bonnes adresses et à ré-envisager l’aliment.
Elle est de ces gens qui appellent tout de suite à la sympathie. À l’aise, installée sur son canapé, elle vous offre amusée une inattendue tasse de menthe poivrée, fraîchement débarquée de Milly-la-Forêt (Essonne). Elle répond sans mauvaise foi, sans enjoliver l’expérience, et rappelle qu’il y a du contraignant, parfois même du frustrant dans le fait de changer d’alimentation. Même quand c’est pour le mieux. Interview.
Qu’est-ce qui t’a motivé à te lancer se défi ?
C’est parti de l’envie de mieux définir le concept de mon blog Eatsider, mangeons nature. Quand on me demandait ce qu’était le manger nature, je bafouillais un peu. Le concept était clair pour moi, il correspond à mon approche de la nourriture : manger pas trop industriel, préférer de qui tombe des arbres et sort de la terre, etc. Ça me semblait même louche de devoir expliquer le concept. Donc plutôt que des mots j’ai décidé d’expliquer la démarche en faisant quelque chose de concret.
Le but était de définir une sorte de charte régie par le local, le circuit court et la saisonnalité des produits. J’aurais bien ajouté plein de choses. Le bio par exemple, mais il y a du bio, du raisonné qui est sans label et qui est très bien aussi. Ou ajouter artisanal, mais finalement ça coulait presque de source : le circuit court répond souvent à ce critère là.
Peux-tu nous expliquer la différence entre le local et le circuit court ?
Pour être considéré comme étant en circuit court, il faut qu’un produit ne soit pas passé par plus d’un intermédiaire. Pour le local il existe plusieurs définitions en fonction du périmètre décidé. Il me semble qu’à l’origine du mouvement locavore la limite fixée étaient de 160 miles, soit 250 km. J’ai gardé ce curseur là pour le local, mais le circuit court m’intéressait davantage. C’est un gage de traçabilité. La garantie aussi d’avoir un produit qui n’a pas été bourré d’additifs pour rester bien rouge et bien en forme. Une tomate achetée en circuit court ne fait pas long feu et est quasiment toujours locale.
Pourquoi cette échéance des 66 jours ?
Mon oncle David est coach personnel. Je lui ai un jour parlé de mon envie de me lancer un défi, comme celui d’arrêter de faire mes courses au supermarché. Il m’a alors conseillé de tenter l’expérience pendant 66 jours, ce qui est le temps moyen estimé pour prendre une nouvelle habitude.
Quand tu t’es lancée, quelle a été la réaction de ton entourage ?
Il y a eu différentes sortes de réactions. Certaines personnes ne voyaient pas l’intérêt du défi. Mais je pense que c’était pour la plupart des gens qui ne s’intéressent pas à leur alimentation et qui appréhende la nourriture comme une consommation de masse. Mes proches qui aiment bien manger ont été les plus sensibles au sujet, même s’ils ont été un peu surpris parce que c’est la première fois que je me lance dans une chose pareille. Mais de manière générale je dirais que ça a suscité pas mal d'incompréhension.
Est-ce que le manger local a changé ton budget course ?
Je ne tenais pas de comptes avant le défi, mais je pense avoir dépensé un peu moins. L’économie se fait sur le superflu : le paquet de gâteaux industriels, les tablettes de chocolats, le fastfood du dimanche quand on a la flemme de cuisiner.
(Elle pose les yeux sur ses fiches bristol raturées - ndlr) Le premier mois j’ai dépensé 261,73 euros. 146, 67 euros le deuxième. J’ai fait pas mal d’erreurs au début, je prenais ce que je trouvais. La deuxième semaine du défi était terrible (elle rit) : je n’avais plus rien à bouffer et l’épicier du quartier me propose les rillettes de sa grand-mère qui a des cochons en Picardie. Je me suis retrouvée avec 500g de rillettes. En rentrant chez moi j’ai compris qu’il ne fallait pas que je me contente de prendre ce qu’on me donnait. C’est aussi ça le problème de l’alimentation industrielle : on prend ce qu’on nous donne, ce qui est à hauteur des yeux. Ces erreurs là m’ont fait comprendre qu’il fallait changer de comportement. La différence de budget vient de ce changement mais aussi du fait que le premier mois je me suis lancée en n’ayant rien : pas de sel, pas de piment, d’huile, de vinaigre, etc. Il a fallu que je refasse tous mes stocks, ce qui coûte un peu cher.

As-tu été contrainte de modifier ta manière de faire les courses ?
J’ai du apprendre à anticiper, sans quoi tu te retrouves avec un frigo vide tous les deux jours. Les produits frais tournent à une vitesse monstre. J’ai compris aussi qu’il me fallait plus de temps. Dès que j’avais du temps libre je le consacrais à la recherche de nouveaux points de vente. Le bouche-à-oreille m’a bien aidé.
Je suis inscrite à la Ruche qui dit oui ! du Xe arrondissaement depuis septembre dernier. Ça m’a beaucoup servi. Ils organisent régulièrement des rencontres avec les producteurs sur leur exploitation. Nous sommes allés chez Nicolas Thirard qui est viticulteur dans la Somme. Nous sommes partis planter des vignes, pour découvrir l’envers du décors. Ça permet de se rendre compte de l’étendue du travail que cela représente. C’est monumental.
Pendant le défi, est-ce que tu as continué à aller faires quelques achats en supermarché ?
Non car je n’avais aucune visibilité sur le circuit court dans les hypermarchés. J’ai essayé d’aller au Biocoop du Canal de l’Ourq près de chez moi mais je n’ai pas trouvé plus de choses. Le vendeur me répondait qu’il avait du local, qu’il y avait du circuit court, mais rarement les deux en même temps. Au début je faisais mes courses le nez collé aux étiquettes, on me prenait pour une folle.
Tu cuisines beaucoup ?
J’ai toujours cuisiné, mais toujours des choses simples. Je cuisine un peu plus depuis le défi, je n’ai pas trop le choix. À moins de croquer dans mes carottes comme ça et manger des oeufs durs tout le temps. Il a fallu que j’apprenne à faire différemment, du coup je suis achetée une mandoline (ustensile de cuisine qui permet de trancher les fruits et légumes facilement), c’est bien utile. Maintenant je cuisine au moins vingt minutes, c’est le minimum pour pouvoir me faire à manger.
Comment t’organisais-tu au travail ?
C’était l’exception, je ne pouvais pas vérifier d’où venaient tous les produits. Je sais en revanche que c’est français. Des gens sur le blog m’ont suggéré de me faire des tupperwares. Mais le projet était de voir comment je pouvait appliquer le local au quotidien, sans que ça ne le bouleverse trop. Si je l’avais fait à 200 % je n’aurais pas pu aller dîner chez des amis. Ce genre de défi peut-être un peu isolant.
Quelles ont été les principales difficultés ?
Il y a un manque d’information sur les lieux où trouver du circuit court. Et un manque de transparence sur l’origine des produits. Je me suis baladée sur les marchés, j’ai demandé aux commerçant s’ils étaient producteurs. J’ai posé la question des milliers de fois et la réponse était toujours non. On m’a répondu qu’on se fournissait à Rungis par exemple. Quand un marchand te propose 200 variétés de fruits et légumes différents tu peux te douter qu’il n’a pas les champs pour produire tout ça lui-même.
Mon oncle David a réussi à trouver un marché à Convention où il a son maraîcher. Un vrai, qui peut vous parler de tous ses produits. Il m’a fait découvrir des produits que je ne connaissais pas : j’ai mangé de la chicorée verte pour la première fois, produite dans le 94. Ça veut bien dire qu’il y a des producteurs locaux sur certains marchés, mais ils sont difficiles à trouver.
A quel moment as-tu enfin trouvé tes marques ?
Je dirais que tout s’est déclenché un peu sur la fin. 66 jours c’est finalement court pour opérer un changement. Pour sûr je vais continuer à chercher, et du coup je ferai une rubrique sur le blog dédiée aux adresses où acheter de bons produits au plus près des producteurs quand on vit à Paris en 2015. Parce que c’est ce qui a été le plus compliqué au début. C’est en poussant les gens à chercher au-delà de l’offre majoritaire que l’on réussira a développer des réseaux intéressants.
Est-ce qu’il y a eu des frustrations ?
Le manque de café était le plus dur. Non pas que je sois une grande buveuse de café, mais c’est un moment social. J’aime le prendre au comptoir le matin, c’est une vieille habitude, un moment à moi. Comme dans tout changement d’habitude il a fallu s’isoler un peu au début. J’ai arrêté de fumer il y a deux ans et ça a été le même procédé. Du coup les premières semaines je sortais moins.
Quand j’allais à des apéros à défaut de trouver des bières je ramenais du vin, il se trouve que j’ai un bon caviste à côté. Je me ramenais avec un morceau de fromage, un morceau de pain. J’ai été obligée de communiquer sur mon challenge, et c’est finalement ce qui a été le plus intéressant. Ça a permis de créer un lien social énorme. J’avais peur que certains me prennent pour une folle. Et puis pas du tout, les gens sont plutôt curieux.
J’ai renoncé à plein d’ingrédients, mais le curcuma est de ceux qui m’ont le plus manqué, parce que j’en utilise beaucoup. Je n’ai pas eu trop de problème pour le reste. J’ai remplacé le poivre par le piment d’espelette.

Qu’est-ce que tu vas garder de ce défi ?
Mon seul extra depuis cinq jours (la fin du défi - ndlr) a été de boire du café. Et c’était chouette (elle rit) !
Avant j’aimais bien parfois me faire des pâtes recouvertes de fromage industriel. Je me dis aujourd’hui que ça n’avait vraiment aucun goût. Parce que c’est évident que beaucoup de choses sont tentantes dans un rayon de supermarché. Mais a-t-on vraiment besoin de toutes ces choses, sont-elles si bonnes que ça, qu’y a-t-il dedans, est-ce que c’est bon pour moi ? Je ne vais pas revenir à la facilité de l’industriel.
Je vais aussi continuer à respecter cette charte que je me suis fixée, même si ce n’est pas à 100 %. Le circuit court est pour moi le plus enrichissant, tant en matière de lien social, de compréhension du travail des artisans, des éleveurs, des agriculteurs. Les produits n’ont plus du tout la même valeur. Ça m’est complètement égal de payer un paquet de pâtes 8 euros. Je vois le produit différemment : ce n’est plus un produit de grande consommation pour moi. Je comprends beaucoup plus tout le chemin du produit, du champ à la meule.
Avant je consommais en fonction de mon budget. En fin de mois je pouvais rogner sur le budget nourriture et quand même m’acheter un jean ou un t-shirt. C’est l’inverse maintenant. Je veux d’abord bien manger.
Quelles astuces donnerais-tu à ceux qui voudraient manger plus local ?
Sans aller jusqu’à se lancer dans ce genre de défi, c’est super intéressant de se dire que l’on va consommer différemment. Même comme ça, de manière plus éparse : se dire qu’une fois sur deux on ne fait plus les courses au supermarché par exemple. Chercher un commerce d’un genre nouveau. Parce qu’il existe de très bons endroits qui ne coûtent pas forcément plus cher. C’est juste que nous sommes trop ancrés dans nos habitudes et ne nous posons pas assez de questions.
Le mot de la fin ?
Pour se poser les bonnes questions sur leur alimentation, j’encourage vraiment les gens à se rapprocher des producteurs. C’est une démarche humaine avant tout : il ne faut pas oublier qu’il y a des hommes derrière les produits.
Découvrez ICI le très joli blog de Marie.